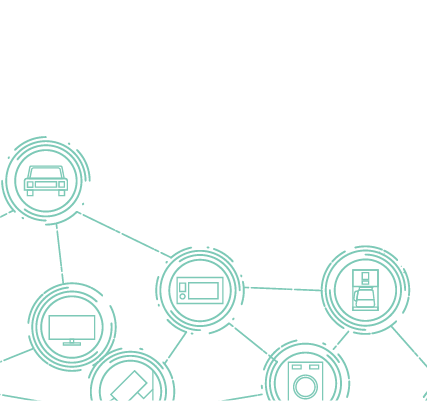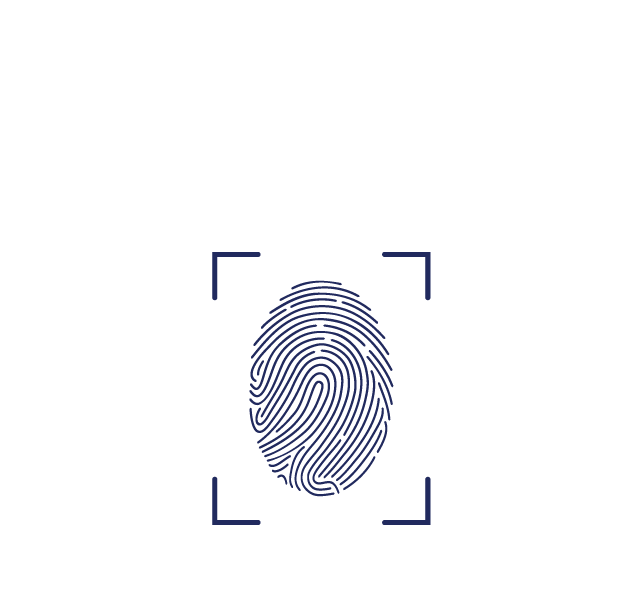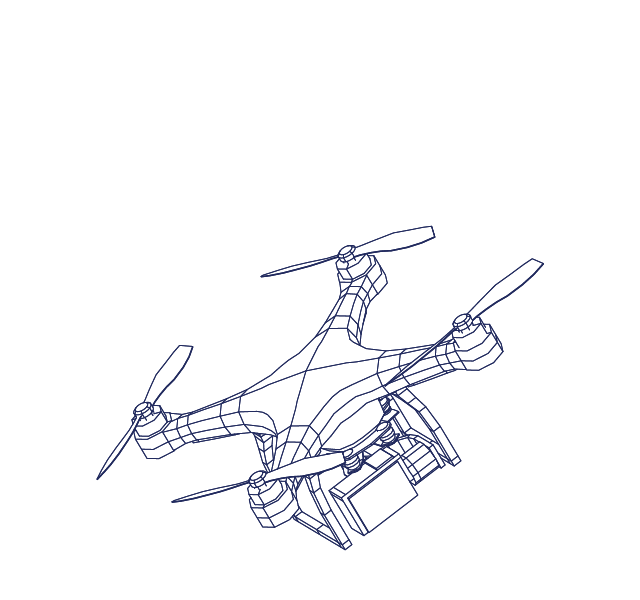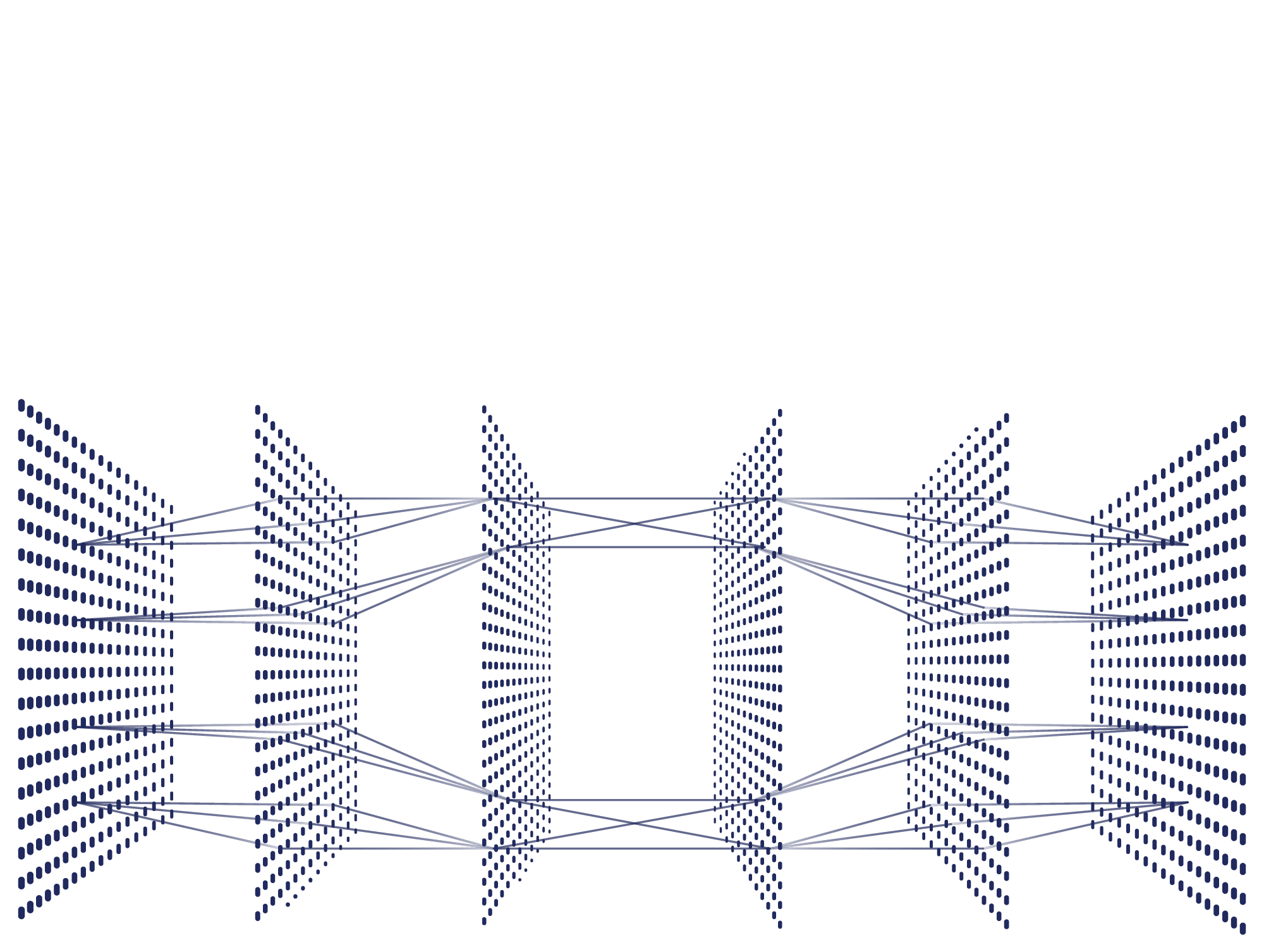Villes intelligentes
Qu’est-ce qu’une ville intelligente ?
Les villes intelligentes peuvent prendre de nombreuses formes, mais elles s’appuient généralement sur des technologies numériques telles que l’Intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour améliorer la qualité de la vie en milieu urbain. Les technologies et la collecte de données qui sont à la base des villes intelligentes ont le potentiel d’automatiser et d’améliorer la prestation de services, de renforcer l’état de préparation face aux catastrophes, d’augmenter la connexion et d’améliorer la participation des citoyens. Mais si les villes intelligentes sont mises en œuvre sans transparence ni respect de l’État de droit, elles risquent d’éroder les normes de bonne gouvernance, de porter atteinte à la vie privée et de mettre fin à la liberté d’expression.
Comment fonctionnent les villes intelligentes ?

Les villes intelligentes intègrent la technologie aux infrastructures nouvelles et existantes – telles que les routes, les aéroports, les bâtiments municipaux et parfois même les résidences privées – afin d’optimiser l’allocation des ressources, d’évaluer les besoins en matière de maintenance et de suivre de près la sécurité des citoyens. Le terme « ville intelligente » ne fait pas référence à une technologie unique, mais plutôt à des technologies multiples qui œuvrent ensemble pour améliorer l’habitabilité d’une zone urbaine. Il n’existe pas de liste officielle des technologies qu’une ville doit mettre en œuvre pour être considérée comme « intelligente ». Mais une ville intelligente nécessite une planification urbaine, y compris une stratégie de croissance gérée par les collectivités locales avec des contributions significatives du secteur privé.
Les données au cœur des villes intelligentesLes villes intelligentes s’appuient généralement sur des outils de traitement et de visualisation des données en temps réel pour éclairer la prise de décision. Il s’agit généralement de recueillir et d’analyser des données provenant de capteurs intelligents installés dans toute la ville et reliés par l’Internet des objets pour traiter des questions telles que la circulation des véhicules, la pollution de l’air, la gestion des déchets et la sécurité physique.
La collecte de données dans les villes intelligentes constitue également un mécanisme de remontée d’information pour renforcer les relations entre les citoyens et les collectivités locales lorsqu’elle s’accompagne de mesures de transparence, telles que la publication d’informations sur les budgets officiels et l’affectation des ressources. Cependant, l’utilisation abusive des données à caractère personnel sensibles peut aliéner les citoyens et réduire la confiance. Une stratégie de gestion des données détaillée et respectueuse des droits permet de s’assurer que les citoyens comprennent (et acceptent) la manière dont leurs données sont collectées, traitées et stockées, et la manière dont elles seront utilisées au profit de la communauté.
Les villes sont extrêmement différentes et la mise en œuvre de solutions de villes intelligentes variera en fonction de l’emplacement, des priorités, des ressources et des capacités. Certaines villes intelligentes sont construites en superposant les TIC à l’infrastructure existante, comme à Nairobi, tandis que d’autres sont construites « à partir de zéro », comme la « Silicon Valley » du Kenya, Konza City. Outre le développement technologique, d’autres éléments non numériques des villes intelligentes comprennent l’amélioration des logements, une plus grande facilité de déplacement à pied, la création de nouveaux parcs, la préservation de la faune et de la flore, etc. En fin de compte, l’accent mis sur l’amélioration de la gouvernance et de la durabilité peut générer de meilleurs résultats pour les citoyens qu’un accent explicite sur la technologie, la numérisation et la croissance.
Les villes intelligentes des pays en développement sont confrontées à des défis juridiques, réglementaires et socio-économiques uniques.
Les facteurs de développement des villes intelligentes dans les pays en développement- Les capacités de financement du gouvernement
- Un environnement réglementaire qui inspire la confiance des citoyens et des investisseurs
- État de préparation des technologies et des infrastructures
- Le capital humain
- La stabilité du développement économique
- L’engagement et la participation active des citoyens
- Le transfert de connaissances et la participation du secteur privé
- Un écosystème qui favorise l’innovation et l’apprentissage
- Les contraintes budgétaires et les questions de financement
- Le manque d’investissement dans les infrastructures de base
- Le manque de préparation des infrastructures liées à la technologie
- Une autorité fragmentée
- L’absence de cadres de gouvernance et de garanties réglementaires
- Le manque de capital humain qualifié
- Les préoccupations d’ordre environnemental
- Le manque de participation des citoyens
- L’analphabétisme technologique et le déficit de connaissances

Le développement d’une ville intelligente qui profite réellement aux citoyens nécessite une planification minutieuse qui prend généralement plusieurs années avant la mise sur pied de l’infrastructure de la ville. La mise en œuvre d’une ville intelligente devrait se faire progressivement, au fur et à mesure que la volonté politique, la demande des citoyens et les intérêts du secteur privé convergent. Les projets de villes intelligentes ne peuvent réussir que lorsque la ville a développé une infrastructure de base et mis en place des protections juridiques pour garantir le respect et la sauvegarde de la vie privée des citoyens. Les infrastructures nécessaires aux villes intelligentes sont coûteuses et nécessitent une maintenance et une révision régulières et permanentes par des professionnels qualifiés. De nombreux projets de villes intelligentes ont été réduits à des cimetières de capteurs oubliés, faute d’une maintenance adéquate ou parce que les données recueillies n’étaient pas utiles au gouvernement et aux populations.
Dénominateurs communs aux villes intelligentesVous trouverez ci-dessous un aperçu des technologies et des pratiques communes aux villes intelligentes, même si cette liste n’est nullement exhaustive ou universelle.
Wi-Fi ouvert : Une connexion Internet abordable et fiable est essentielle pour une ville intelligente. Certaines villes intelligentes offrent un accès gratuit à l’Internet à haut débit grâce à une infrastructure sans fil à l’échelle de la ville. Le Wi-Fi gratuit peut faciliter la collecte de données, soutenir les services d’intervention d’urgence et encourager les habitants à fréquenter les lieux publics.
Internet des objets (IoT) : L’Internet des objets est un réseau en expansion de dispositifs physiques connectés par l’Internet. Des véhicules aux réfrigérateurs en passant par les systèmes de chauffage, ces appareils communiquent avec les utilisateurs, les développeurs, les applications et entre eux en collectant, en échangeant et en traitant des données. Par exemple, les données collectées par les compteurs d’eau intelligents peuvent permettre de mieux répondre à des problèmes tels que les fuites d’eau ou le gaspillage d’eau. L’IdO est largement facilité par l’essor des smartphones qui permettent aux gens de se connecter facilement les uns aux autres et à d’autres appareils.
5G: Les services des villes intelligentes ont besoin d’un Internet à haut débit et d’une large bande passante pour gérer la quantité de données générées par l’IdO et pour traiter ces données en temps réel. La connexion et les capacités de calcul accrues de l’infrastructure Internet 5G facilitent de nombreux processus liés à l’Internet qui sont nécessaires aux villes intelligentes.
Réseaux intelligents : Les réseaux intelligents sont des réseaux énergétiques qui utilisent des capteurs pour collecter des données en temps réel sur l’utilisation de l’énergie et les besoins des infrastructures et des populations. Au-delà du contrôle des services publics, les réseaux intelligents surveillent l’énergie, distribuent les données haut débit pour améliorer la connexion et contrôlent des processus tels que le trafic. Les réseaux intelligents reposent sur un ensemble d’opérateurs de systèmes électriques et impliquent un large réseau de parties, notamment des vendeurs, des fournisseurs, des entrepreneurs, des opérateurs de production distribuée et des consommateurs.
Système de transport intelligent (STI) : Les systèmes de transport intelligents permettent de coordonner divers mécanismes de transport afin de réduire la consommation de l’énergie, les embouteillages et la durée des trajets. Les STI se concentrent sur la « livraison du dernier kilomètre », c’est-à-dire sur l’optimisation de la dernière étape du processus de livraison. Les véhicules autonomes sont souvent associés aux villes intelligentes, mais les STI vont bien au-delà des véhicules individuels.
Surveillance : à l’instar des objets connectés, les données concernant les résidents peuvent être transmises, agrégées et analysées. Dans certains cas, les caméras de vidéosurveillance existantes peuvent être associées à un logiciel d’analyse vidéo avancé et reliées à l’IdO pour gérer la circulation et la sécurité publique. Les solutions pour les infrastructures de vidéosurveillance fixes représentent l’essentiel de la surveillance des villes intelligentes dans le monde, mais les solutions de surveillance mobile connaissent également un essor rapide. L’extension de la surveillance à l’identification des personnes est un sujet très débattu qui a des ramifications importantes pour la société civile et les acteurs du DRG.
Identité numérique et prestation de services: les services d’identification numérique peuvent relier les citoyens à leur ville en facilitant l’ouverture d’un compte bancaire ou l’accès aux services de santé. Les cartes d’identité numériques centralisent toutes les informations et l’historique des transactions, ce qui est pratique pour les citoyens mais pose également des problèmes de sécurité. Des techniques telles que la divulgation minimale (en s’appuyant sur le moins de données possible) et des technologies décentralisées telles que l’identité souveraine (SSI) peuvent aider à séparer l’identité, la transaction et l’appareil.
E-gouvernement : Le gouvernement électronique – l’utilisation de la technologie pour fournir des services gouvernementaux au public – vise à améliorer la prestation de services, à renforcer l’engagement des citoyens et à instaurer la confiance. Rendre plus d’informations, telles que les budgets gouvernementaux, publiques et disponibles pour les citoyens est un élément essentiel du gouvernement électronique. La technologie mobile combinée à une plate-forme d’administration en ligne peut offrir aux citoyens un accès à distance aux services municipaux.
Directeur des technologies : Certaines villes intelligentes disposent d’un Directeur des technologies (DdT) ou d’un Directeur de l’information (DdI), qui oriente les efforts de la ville pour développer des solutions technologiques créatives et efficaces en collaboration avec les habitants et les élus. Le DdT ou le DdI étudie la communauté, s’informe des besoins des citoyens, planifie et exécute les initiatives correspondantes, et supervise la mise en œuvre et les améliorations continues.
L’interopérabilité : Les nombreux services et outils différents utilisés dans une ville intelligente doivent pouvoir fonctionner ensemble, communiquer entre eux et partager des données. Cela nécessite un dialogue et une planification minutieuse entre les fournisseurs des entreprises et les autorités municipales. L’interopérabilité s’entend que la nouvelle infrastructure doit pouvoir fonctionner en plus de l’infrastructure existante d’une ville (par exemple, l’installation d’un nouvel éclairage LED “intelligent” en plus des systèmes d’éclairage public existants).
« Une ville intelligente est un processus d’amélioration continue des méthodes de fonctionnement de la ville. Pas un big bang ».
En quoi les villes intelligentes sont-elles pertinentes pour l'espace civique et la démocratie ?
Comme décrit plus en détail dans la section « Opportunités » de cette ressource, les villes intelligentes peuvent améliorer l’efficacité énergétique, la préparation aux catastrophes et la participation citoyenne. Mais les villes intelligentes sont, à bien des égards, une arme à double tranchant, et elles peuvent également faciliter une surveillance excessive et porter atteinte aux droits à la liberté de réunion et d’expression.

Dans les pays à régime autoritaire, les villes intelligentes peuvent devenir de puissants instruments de manipulation et de contrôle. Les villes intelligentes en Chine, par exemple, sont liées au concept de « gestion sociale » du parti communiste chinois, ou aux tentatives du parti au pouvoir de façonner, gérer et contrôler la société. Lorsqu’elles sont mises en œuvre sans transparence ni respect de l’État de droit, les technologies des villes intelligentes – comme un compteur électrique intelligent destiné à améliorer la précision des relevés – peuvent être utilisées abusivement par le gouvernement comme indicateur de comportements « anormaux » révélateurs de rassemblements « illégaux ». Dans des cas extrêmes, la surveillance et le contrôle facilités par les villes intelligentes pourraient dissuader les citoyens de se rassembler L’implication d’acteurs autoritaires dans la conception et l’exploitation des villes intelligentes représente une menace importante pour la démocratie, en particulier dans les pays où préexistent des tendances non libérales ou des institutions de contrôle faibles. Les partenaires de l’entreprise technologique chinoise Huawei, qui fournit des « solutions » pour les villes intelligentes, telles que la reconnaissance faciale et la reconnaissance des plaques d’immatriculation, le suivi des médias sociaux et d’autres capacités de surveillance, ont tendance à à ne pas être libéraux, ce qui fait craindre que le parti communiste chinois ne fasse l’exportateur de l’autoritarisme. Dans au moins deux cas, les techniciens de Huawei « ont aidé des gouvernements africains espionner leurs opposants politiques, notamment interceptant leurs communications cryptées et leurs médias sociaux, et en utilisant des données cellulaires pour les localiser ».
Le développement d’une ville intelligente respectueuse des droits nécessite la participation active de la société, depuis les premières étapes de la planification jusqu’à la mise en œuvre du projet. Des mécanismes permettant aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations et de fournir un retour d’information pourraient grandement contribuer à instaurer la confiance et à encourager la participation civique à long terme. Des programmes d’éducation et de formation devraient également être mis en œuvre lors de la planification des villes intelligentes afin d’aider les citoyens à comprendre comment utiliser la technologie qui les entoure, ainsi que les avantages qu’elle leur apportera dans leur vie quotidienne.
Les villes intelligentes peuvent créer de nouvelles voies de participation aux processus démocratiques tels que le vote électronique. Les adeptes du vote électronique mettent l’accent sur les avantages, tels que « des résultats plus rapides, la réduction des coûts et l’accessibilité à distance, qui peuvent potentiellement augmenter la participation électorale ». Mais ils ont tendance à « sous-estimer les risques tels que la fraude électorale, les failles de sécurité, les problèmes de vérification, les bugs et les défaillances des logiciels ». Si les villes intelligentes s’articulent autour de politiques axées sur la technologie, les défis auxquels sont confrontées les communautés urbaines nécessitent des solutions structurelles dont la technologie n’est qu’un élément parmi d’autres.

La technologie des villes intelligentes peut également déboucher sur une infrastructure gouvernementale privatisée, ce qui, en fin de compte, « déplace les services publics, remplace la démocratie par des décisions prises par des entreprises et permet aux agences gouvernementales de se soustraire aux protections constitutionnelles et aux lois sur la responsabilité en faveur de la collecte de plus de données ». Dans certains cas, les autorités qui s’efforcent d’obtenir des contrats pour les technologies des villes intelligentes ont refusé de divulguer des informations sur les négociations ou ont carrément contourné les procédures normales de passation des marchés publics.
Ainsi, les normes de protection de la vie privée, les réglementations sur la protection des données et les dispositifs de respect des procédures sont autant de composantes essentielles d’une ville intelligente qui profite réellement aux citoyens. Une infrastructure juridique solide peut également offrir aux citoyens un recours en cas de discrimination ou d’abus, même avant le développement d’une ville intelligente. En Inde, « la campagne en faveur des villes intelligentes a entraîné l’expulsion de personnes vivant dans des bidonvilles et des quartiers informels, sans compensation adéquate ni solution de relogement ». Trop souvent, les villes intelligentes qui se veulent « inclusives » profitent avant tout à l’élite et ne répondent pas aux besoins des femmes, des enfants, des migrants, des minorités, des personnes en situation de handicap, des personnes travaillant dans l’économie informelle, des groupes à faibles revenus ou des personnes ayant un faible niveau de culture numérique. Étant donné que les normes juridiques varient d’un pays à l’autre, les cadres des droits de l’homme peuvent contribuer à éclairer la mise en œuvre équitable des villes intelligentes pour s’assurer qu’elles bénéficient à l’ensemble de la société, y compris aux communautés vulnérables. La société civile et les gouvernements doivent se demander 1) si la technologie est adaptée à l’objectif et permet de l’atteindre, 2) si la technologie est nécessaire en ce sens qu’elle ne va pas au-delà de son but et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’atteindre l’objectif, et 3) si la technologie est proportionnée, c’est-à-dire que les défis ou les inconvénients qui y sont liés ne l’emportent pas sur les avantages du résultat.
Les opportunités
Les villes intelligentes peuvent avoir un certain nombre d’effets positifs lorsqu’elles sont utilisées pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance.
Durabilité environnementaleSelon l’OCDE, les villes modernes consomment près des deux tiers de l’énergie mondiale, produisent jusqu’à 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et génèrent 50 % des déchets mondiaux. Les villes intelligentes peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable N° 11, qui consiste à rendre les villes et les installations humaines inclusives, sûres, résilientes et durables, en exploitant les données pour améliorer l’efficacité économique et la distribution d’énergie, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone d’une ville et d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’énergies renouvelables. Les villes intelligentes sont souvent liées à des pratiques d’économie circulaire, qui comprennent le « recyclage » des eaux de pluie, des déchets et même des données publiques ouvertes (voir ci-dessous). En outre, les technologies des villes intelligentes peuvent être mises à profit pour contribuer à prévenir la perte de biodiversité et d’habitats naturels.
Les villes intelligentes peuvent contribuer à améliorer la préparation, la réduction, la réaction et la relance en cas de catastrophe. La collecte et l’analyse de données peuvent être appliquées à la surveillance des menaces à l’environnement, et les capteurs à distance peuvent cartographier les risques. Par exemple, les données ouvertes et l’intelligence artificielle peuvent être utilisées pour identifier les zones les plus susceptibles d’être les plus durement touchées par les tremblements de terre. Les systèmes d’alerte précoce, les systèmes d’alerte des médias sociaux, les SIG et les systèmes mobiles peuvent également contribuer à la gestion des catastrophes. Dans une ville intelligente, les systèmes interconnectés peuvent partager des informations sur les zones qui ont besoin d’assistance ou de réapprovisionnement lorsque les canaux de communication individuels sont interrompus.
Les villes intelligentes peuvent faciliter l’inclusion sociale de manière significative, grâce à un accès rapide et sécurisé à l’Internet, à l’amélioration de l’accès aux services gouvernementaux et sociaux, aux possibilités de contribution et de participation des citoyens, à l’amélioration des transports et de la mobilité urbaine, etc. Par exemple, les villes intelligentes peuvent établir un réseau de points d’accès urbains où les habitants peuvent accéder à une formation aux compétences numériques, tandis que la numérisation des services de santé peut améliorer les possibilités de soins de santé et aider les patients à se connecter à leur dossier médical. Les villes peuvent même améliorer les services destinés aux groupes vulnérables en exploitant de manière responsable des jeux de données sensibles afin de mieux comprendre les besoins de ces citoyens – même si ces données doivent être fournies avec un consentement total et que des garanties solides en matière de confidentialité et de sécurité doivent être mises en place. Les technologies des villes intelligentes peuvent également servir à préserver le patrimoine culturel.
Une approche ouverte des données capturées par les technologies intelligentes peut rapprocher les gouvernements, les entreprises et la société civile. Les données publiques ou ouvertes – contrairement aux données sensibles et privées – sont des données que tout le monde peut accéder, utiliser et partager. Une approche des données en libre accès revient à permettre au public d’accéder à ce type de données publiques et réutilisables afin d’en tirer des avantages sociaux et économiques. Cette approche peut également assurer la transparence et renforcer la responsabilité et la confiance entre les citoyens et le gouvernement, par exemple en montrant l’utilisation des fonds publics. Outre les données ouvertes, la conception des logiciels qui soutiennent l’infrastructure des villes intelligentes peut être partagée avec le public par le biais d’une conception à source ouverte et de normes ouvertes. L’Open Source fait référence à une technologie dont le code source est librement accessible au public, de sorte que chacun peut l’examiner, le reproduire, le modifier ou l’étendre. Les normes ouvertes sont des lignes directrices qui permettent de s’assurer que la technologie est conçue pour être open source en premier lieu.
Les villes intelligentes peuvent encourager les citoyens à participer plus activement à leur communauté et à leur gouvernance en facilitant le bénévolat et les possibilités d’engagement communautaire et en sollicitant un retour d’information sur la qualité des services et des infrastructures. Parfois appelés « e-participation », les outils numériques peuvent réduire les barrières entre les citoyens et la prise de décision, en facilitant leur implication dans l’élaboration des lois et des normes, dans le choix des initiatives urbaines, etc. Les Nations unies identifient trois étapes dans la participation électronique : E-information, E-consultation et E-décision.
Risques
L’utilisation des technologies émergentes peut également créer des risques dans les programmes de la société civile. Cette section décrit comment discerner les dangers éventuels associés aux villes intelligentes dans le travail de DRG, ainsi que la façon d’atténuer les conséquences involontaires et intentionnelles.
Surveillance et participation forcéeComme indiqué plus haut, les villes intelligentes reposent souvent sur un certain niveau de surveillance des citoyens, dont les inconvénients ne sont généralement pas mis en avant dans les campagnes de marketing. Un projet de ville intelligente à Toronto, au Canada, présenté comme un outil permettant de résoudre les problèmes d’accessibilité et de transport dans la ville, a finalement échoué en raison de la pandémie de la COVID-19 et d’un examen approfondi de la question de la protection de la vie privée et de la collecte de données.
Dans de nombreux pays, les personnes doivent donner leur consentement éclairé pour que leurs données soient légalement collectées, stockées et analysées. Même si les utilisateurs acceptent aveuglément de fournir leurs données à un site web ou à une application, il existe au moins une option claire pour refuser de le faire. Dans les espaces publics, cependant, il n’y a pas de moyen direct de refuser de donner son consentement. Les citoyens consentent-ils à être surveillés lorsqu’ils traversent la rue ? Ont-ils été informés de l’utilisation qui sera faite des données recueillies sur leurs déplacements et leurs comportements ? Dans les démocraties, il existe des possibilités de recours en cas d’utilisation abusive des données personnelles collectées dans le cadre de la surveillance, mais ce n’est pas toujours le cas dans les contextes non libéraux. En Chine, par exemple, l’utilisation de millions de caméras de surveillance qui reconnaissent les visages, les formes du corps et la façon dont les gens marchent facilite le suivi des individus afin d’étouffer la dissidence.
La discrimination est parfois facilitée par la surveillance des villes intelligentes et la technologie de reconnaissance faciale. L’infrastructure des villes intelligentes peut permettre aux forces de l’ordre et aux agences de sécurité de suivre et de cibler certains groupes tels que les minorités ethniques ou raciales. Cela se produit dans les sociétés démocratiques comme dans les sociétés non démocratiques. Une étude réalisée en 2019 par l’Institut national américain des normes et de la technologie a révélé que les algorithmes de reconnaissance faciale sont peu performants lorsqu’ils examinent les visages de femmes, de personnes de couleur, de personnes âgées et des enfants. Cette situation est d’autant plus préoccupante que de nombreux services de police utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les suspects et procéder à des arrestations. Outre la reconnaissance faciale, l’analyse des données est utilisée pour anticiper les lieux potentiels de futurs crimes (une pratique connue sous le nom de maintien de l’ordre prédictif). La réponse typique à cette analyse est un renforcement de la surveillance des zones « à haut risque », souvent des quartiers habités par des communautés à faibles revenus et des minorités.
Au fur et à mesure qu’une ville se connecte numériquement, le partage des données augmente. Par exemple, l’utilisateur d’un smartphone peut partager des données de géolocalisation et d’autres métadonnées avec plusieurs applications, qui à leur tour partagent ces données avec d’autres services. Pourtant, à mesure que les villes rassemblent et traitent des données sur les habitants, les attentes en matière de respect de la vie privée dans la vie quotidienne s’estompent. La collecte de certains types de données, comme les informations sur les trajets que vous avez effectués en voiture ou la vitesse à laquelle vous conduisez habituellement, peut sembler inoffensives. Mais lorsqu’elles sont associées à d’autres données, des tendances se dessinent rapidement et peuvent révéler des informations plus sensibles sur votre santé et vos habitudes, votre famille et vos réseaux, la composition de votre foyer, vos pratiques religieuses, etc.
Les informations personnelles sont précieuses pour les entreprises, et nombre d’entre elles testent leur technologie dans les pays où les restrictions en matière de données sont les plus faibles. Entre les mains d’entreprises privées, les données peuvent être exploitées à des fins de ciblage publicitaire, de calibrage des coûts d’assurance, etc. Il existe également des risques lorsque les données sont collectées par des tiers (en particulier des entreprises étrangères) qui peuvent verrouiller les utilisateurs dans leurs services, négliger de partager des informations sur les failles de sécurité, avoir des mécanismes de protection des données inadéquats ou maintenir des accords de partage de données avec d’autres gouvernements. Les gouvernements peuvent également tirer profit de l’accès à des données intimes sur leurs citoyens : « Les informations personnelles collectées dans le cadre d’une enquête sur la santé pourraient être réutilisées pour un client qui serait, par exemple, un parti politique désireux de remporter une élection. » Selon l’innovateur social et entrepreneur ghanéen Bright Simmons, « la bataille pour la protection des données et les droits numériques est le nouveau combat pour les droits civiques sur le continent ».
Dans de nombreux cas, les smartphones et les applications qu’ils contiennent facilitent l’accès à tous les avantages d’une ville intelligente. En 2019, on estime à cinq milliards le nombre de personnes possédant un appareil mobile, dont plus de la moitié sont des smartphones. Mais ces chiffres varient entre les économies développées et les économies en développement, ainsi qu’entre les communautés ou les groupes au sein d’une économie donnée, ce qui peut engendrer des inégalités dans l’accès aux services et à la participation civique. Les citoyens ayant un faible niveau d’alphabétisation et de connaissances en calcul, ou qui ne parlent pas la langue utilisée par une application, auront encore plus de difficultés à se connecter par le biais de ces interfaces. La dépendance à l’égard des applications éloigne également les populations non logées qui peuvent ne pas être en mesure de recharger régulièrement leurs appareils ou qui courent un risque plus élevé de se les faire voler.
Le terme « fracture numérique » désigne généralement l’écart entre les personnes qui ont accès à des technologies de haute qualité et sûres et celles qui n’y sont pas familiarisées. Il est reproché souvent aux villes intelligentes d’être conçues pour l’élite et de ne privilégier que ceux qui sont déjà connectés numériquement. Si tel est le cas, les villes intelligentes pourraient exacerber la gentrification et le déplacement des personnes non logées.
L’utilisation de la surveillance dans les villes intelligentes peut également servir à réprimer les groupes minoritaires. La surveillance exercée par le gouvernement sur la population musulmane ouïghoure du Xinjiang en Chine a fait l’objet de nombreux reportages.
« Elle rassemble des données – depuis le groupe sanguin et de la taille des personnes jusqu’aux informations sur leur consommation d’électricité en passant par les livraisons de colis – et alerte les autorités lorsqu’elle juge quelqu’un ou quelque chose de suspect. Elle fait partie de la Plate-forme intégrée d’opérations conjointes (IJOP en anglais), le principal système de surveillance de masse dans le Xinjiang »TEL QUE DÉCRIT PAR HUMAN RIGHTS WATCH
Les villes intelligentes ont été accusées de « despotisme des données ». Si les autorités municipales peuvent accéder à autant de données sur leurs citoyens, à quoi bon s’adresser directement à eux ? En raison de la discrimination algorithmique potentielle, de failles dans l’analyse et l’interprétation des données, ou des inefficacités entre la technologie et les humains, une dépendance excessive à l’égard de la technologie numérique peut nuire aux plus vulnérables de la société.
Il existe également une abondante littérature sur l’« État-providence numérique ». Philip Alston, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, a observé que les nouvelles technologies numériques modifient les relations entre les gouvernements et les personnes qui ont le plus besoin de protection sociale : « Des décisions cruciales concernant le passage au numérique ont été prises par des ministres sans consultation, ou même par des fonctionnaires ministériels sans qu’aucune discussion politique significative n’ait eu lieu. »
Lorsque les services humains de base sont automatisés et que les opérateurs humains sont exclus de la transaction, les pépins dans le logiciel et les petites failles dans les systèmes d’éligibilité peuvent s’avérer dangereux, voire mortels. En Inde, où de nombreux services sociaux ont été automatisés, un homme de 50 ans est mort de malnutrition à cause d’une erreur dans l’identification biométrique de son empreinte de pouce qui l’empêchait d’accéder à un magasin de rations. « Les décisions vous concernant sont prises par un serveur centralisé, et vous ne savez même pas ce qui a mal tourné… Les gens ne savent pas pourquoi [l’aide sociale] a cessé et ils ne savent pas à qui s’adresser pour résoudre le problème », explique Reetika Khera, Professeur agrégé d’économie à l’Indian Institute of Management Ahmedabad.
Ces processus automatisés créent également de nouvelles opportunités de corruption. Les prestations telles que les pensions et les salaires liés au système d’identification numérique de l’Inde (appelé Aadhaar) sont souvent retardées ou ne parviennent pas du tout à leurs bénéficiaires. Lorsqu’une femme de 70 ans a découvert que sa pension était versée sur le compte bancaire d’une autre personne, le gouvernement lui a demandé de résoudre la situation en s’adressant directement à cette personne.
À l’instar d’autres projets urbains, le développement des villes intelligentes peut entraîner le déplacement d’habitants lorsque des quartiers existants sont rasés au profit de nouvelles constructions. On estime que 60 à 80 % des personnes déplacées de force dans le monde vivent dans des zones urbaines (et non dans des camps comme beaucoup le pensent), et qu’un milliard de personnes (un chiffre qui devrait doubler à l’horizon 2030) dans les villes en développement vivent dans des « bidonvilles », définis par les Nations unies comme des zones dépourvues d’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à la sécurité, à un logement durable et à une surface habitable suffisante. En d’autres termes, les zones urbaines abritent de nombreuses populations parmi les plus vulnérables de la société, notamment des déplacés de l’intérieur du pays et des migrants qui ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que les citoyens. Les villes intelligentes peuvent sembler être une solution idéale aux défis urbains, mais elles risquent de désavantager encore plus ces groupes vulnérables ; sans compter que les villes intelligentes négligent totalement les besoins des populations rurales.
Les villes intelligentes représentent une énorme opportunité de marché pour le secteur privé, suscitant des craintes de « privatisation de la gouvernance urbaine ». Les grandes entreprises d’informatique, de télécommunications et de gestion de l’énergie telles que Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu, Cisco, Google, Schneider Electric, IBM et Microsoft sont les moteurs de la technologie pour les initiatives de villes intelligentes. Comme l’explique Sara Degli-Esposti, chargée de recherche honoraire à l’université de Coventry, « Nous ne pouvons pas comprendre les villes intelligentes sans parler des modèles d’entreprise des géants du numérique… Ces sociétés sont déjà des entités mondiales qui échappent en grande partie à la surveillance des gouvernements. Quel niveau de contrôle les collectivités locales comptent-elles exercer sur ces acteurs ? »
Le rôle important ainsi accordé aux entreprises privées internationales dans la gouvernance municipale soulève des questions de souveraineté pour les gouvernements, ainsi que les problèmes de protection de la vie privée des citoyens cités plus haut. En outre, la dépendance à l’égard des logiciels et des systèmes du secteur privé peut créer une situation de blocage des entreprises (lorsqu’il devient trop coûteux de passer à un autre fournisseur). Le blocage des entreprises peut s’aggraver avec le temps : au fur et à mesure que de nouveaux services sont ajoutés à un réseau, le coût du passage à un nouveau système devient encore plus prohibitif.
La connexion d’appareils par l’intermédiaire d’un réseau intelligent ou de l’Internet de objets entraîne de graves vulnérabilités en matière de sécurité pour les personnes et les infrastructures. Les réseaux connectés présentent davantage de points de vulnérabilité et sont susceptibles d’être piratés et de faire l’objet de cyberattaques. Plus les systèmes intelligents collectent de plus en plus de données personnelles sur les utilisateurs (dossiers médicaux par exemple), plus le risque que des acteurs non autorisés accèdent à ces informations s’accroît. La commodité du Wi-Fi public et ouvert a également un coût, parce qu’il est beaucoup moins sûr que les réseaux privés. L’IdO a été largement critiqué pour son manque de sécurité, en partie à cause de sa nouveauté et de l’absence de réglementation. Les appareils connectés sont généralement fabriqués pour être peu coûteux et accessibles, sans placer la cyber sécurité au cœur des préoccupations.
Plus les infrastructures sont étroitement liées, plus une attaque peut être rapide et de grande envergure. Les infrastructures numériques telles que les réseaux intelligents accroissent les risques de cyber sécurité en raison du nombre accru d’opérateurs et de tiers connectés au réseau, ce qui multiplie les considérations relatives à la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement. Selon Anjos Nijk, Directeur du Réseau européen pour la cyber sécurité : « Avec la vitesse actuelle de numérisation des systèmes de réseau […] et la vitesse de connexion de nouveaux systèmes et technologies aux réseaux, tels que les compteurs intelligents, la recharge des véhicules électriques et l’IdO, les systèmes de réseau deviennent vulnérables et la ‘surface d’attaque’ s’étend rapidement. » L’endommagement d’une partie d’un grand système interconnecté peut avoir un effet en cascade sur d’autres systèmes, ce qui peut entraîner des pannes d’électricité à grande échelle ou la mise hors service d’infrastructures de santé et de transport essentielles. Les réseaux énergétiques peuvent être mis hors service par des pirates informatiques, comme l’a montré la cyberattaque du réseau électrique ukrainien en décembre 2015.
Questions
Si vous essayez de comprendre les implications des villes intelligentes dans votre environnement de travail, ou si vous envisagez d’utiliser des aspects des villes intelligentes dans le cadre de votre programme de DRG, posez-vous les questions suivantes :
-
Le service en question doit-il être numérique ou connecté à l’Internet ? La numérisation améliorera-t-elle ce service pour les citoyens, et l’amélioration escomptée l’emporte-t-elle sur les risques ?
-
Des programmes sont-ils mis en place pour garantir que les besoins fondamentaux des citoyens sont satisfaits (accès à la nourriture, à la sécurité, au logement, aux moyens de subsistance, à l’éducation) ?
-
Quels sont les acteurs externes qui contrôlent les aspects critiques de la technologie et de l’infrastructure sur lesquelles ce projet s’appuiera-t-il, ou qui y ont accès, et quelles sont les mesures de cyber sécurité en place ?
-
Qui construira et assurera la maintenance de l’infrastructure et des données ? Y a-t-il un risque de se voir confiné dans certaines technologies ou dans des accords avec des fournisseurs de services ?
-
Qui a accès aux données collectées et comment les données sont-elles interprétées, utilisées et stockées ? Quels sont les acteurs externes qui y ont accès ? Les données sont-elles disponibles pour une réutilisation sûre et légale par le public ? Comment les données ouvertes sont-elles réutilisées ou partagées publiquement ?
-
Comment les services de la ville intelligente respecteront-ils la vie privée des citoyens ? Comment le consentement des habitants sera-t-il obtenu lorsqu’ils utiliseront des services qui recueillent des données les concernant ? Quelles sont les protections juridiques en place en matière de protection des données et de la vie privée ?
-
Les services intelligents sont-ils transparents et fiables ? Les chercheurs et la société civile ont-ils accès au fonctionnement « en coulisses » de ces services (données, code, API, algorithmes, etc.) ?
-
Quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre les préjugés dans ces services ? Comment ce service sera-t-il sûr de ne pas exacerber les barrières socio-économiques et les inégalités existantes ? Quels sont les programmes et les mesures mis en place pour améliorer l’inclusion ?
-
Comment ces développements respecteront-ils et préserveront-ils les sites et quartiers historiques ? Comment les changements seront-ils adaptés aux identités culturelles locales ?
Études de cas
Barcelona, SpainBarcelona est souvent considérée comme une ville intelligente exemplaire en raison de sa conception fortement démocratique et axée sur les citoyens. Son infrastructure de ville intelligente se compose de trois éléments principaux : Sentilo, une plateforme de collecte de données à code source ouvert ; CityOS, un système de traitement et d’analyse des données collectées ; et des interfaces utilisateurs qui permettent aux citoyens d’accéder aux données. Cette conception à source ouverte atténue le risque de verrouillage des entreprises et permet aux citoyens de conserver la propriété collective de leurs données, ainsi que de contribuer à leur traitement. Une plateforme numérique participative, Decidim (« Nous décidons »), permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques en proposant des idées et en les débattant. Barcelona a également mis en place des initiatives de démocratie électronique et des projets visant à améliorer la culture numérique de ses citoyens. En 2018, Francesca Bria, responsable en chef de la technologie et de l’innovation numérique à Barcelona, a commenté l’inversion du paradigme de la ville intelligente : « Au lieu de partir de la technologie et d’extraire toutes les données possibles avant de réfléchir à la manière de les utiliser, nous avons commencé à aligner l’agenda technologique sur l’agenda de la ville. »
À partir de 2019, le gouvernement serbe a commencé à mettre en œuvre un projet Safe City dans la capitale, Belgrade. L’installation de 1 200 caméras de surveillance intelligentes fournies par le géant chinois de la technologie Huawei a suscité l’inquiétude du public, de la société civile et même de certaines institutions de l’Union européenne. Le Commissaire serbe en charge des informations d’importance publique et de la protection des données personnelles a été l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme, déclarant qu’il n’existait pas de base juridique pour la mise en œuvre du projet Safe City et qu’une nouvelle réglementation était nécessaire pour prendre en compte la technologie de reconnaissance faciale et le traitement des données biométriques. Comme l’a fait remarquer Danilo Krivokapić, Directeur de la SHARE Foundation, une organisation de défense des droits numériques basée à Belgrade, , « le public n’a pas été informé de la portée technique ou du prix du système, des besoins spécifiques auxquels il était censé répondre ou des garanties qui seraient nécessaires pour atténuer les risques potentiels en matière de droits de l’homme.» Afin d’améliorer la transparence du projet, la fondation SHARE a élaboré une carte participative indiquant les emplacements vérifiés des caméras et leurs caractéristiques techniques, qui s’est avérée très différente de la liste des emplacements des caméras fournies par les autorités. Deux ans après le lancement du projet Safe City à Belgrade, un groupe d’Eurodéputés a écrit une lettre au ministre de l’Intérieur du Parlement européen pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que Belgrade devienne « la première ville d’Europe dont la grande majorité du territoire est couverte par des technologies de surveillance de masse.»
Konza Technopolis, l’un des fleurons du plan de développement économique Vision 2030 du Kenya, promet d’ être une « ville de classe mondiale, alimentée par un secteur de l’information, de la communication et des technologies (TIC) florissant, une infrastructure fiable de qualité supérieure et des systèmes de gouvernance favorables aux entreprises. » Les projets pour la ville prévoient la collecte de données à partir de dispositifs intelligents et de capteurs intégrés dans l’environnement urbain afin de fournir des services améliorés par le biais du numérique. Selon le site officiel de Konza, la population de la ville aura un accès direct aux données collectées (notamment les cartes de circulation, les alertes d’urgence et les informations sur la consommation d’énergie et d’eau), ce qui permettra aux citoyens de « participer directement aux activités de la ville, de pratiquer des modes de vie plus durables et d’améliorer l’inclusion globale. » Entre l’annonce des plans de développement de Konza en 2008 et le voyage d’un journaliste dans la ville en 2021, peu de progrès semblent avoir été réalisés malgré les affirmations de selon lesquelles la ville créerait 100 000 emplois d’ici 2020 et générerait jusqu’à 1 milliard de dollars par an pour l’économie kenyane. Cependant, l’investissement de la Corée du Sud pourrait avoir insufflé une nouvelle vie au projet en 2023, vu que de nouveaux projets ont été mis en place, y compris le développement d’un système de transport intelligent (STI) et d’un centre de contrôle intégré.
En 2021, le Prince héritier saoudien Mohamed bin Salman a révélé les premiers plans de The Line, une ville linéaire futuriste qui serait construite verticalement et qui ne comporterait ni routes ni voitures mais qui fonctionnerait uniquement grâce aux énergies renouvelables. Le projet de The Line fait partie du projet de mégapole Neom, d’une valeur de 500 milliards de dollars, qui a été décrit non pas seulement comme une ville « intelligente », mais comme une ville « cognitive ». Cette ville cognitive repose sur trois piliers : « la capacité des habitants et des entreprises à se connecter numériquement à des objets physiques ; la capacité à calculer ou à analyser ces objets ; et la capacité à contextualiser, en utilisant cette connectivité pour prendre de nouvelles décisions ». Les documents de planification produits par des consultants américains incluent certaines technologies qui n’existent même pas encore, telles que les taxis volants, l’ensemencement des nuages pour produire de la pluie et les servantes robots. En plus d’être quelque peu fantaisiste, le projet a également été controversé dès le départ. Environ 20 000 personnes, dont des membres de la tribu indigène des Huwaitat, ont été déplacées de force en raison de la construction du projet. Selon Al Jazeera, un éminent militant des Huwaitat a été arrêté et emprisonné en 2020 en raison du refus de la tribu de se faire déplacer. Le renforcement des liens entre le prince héritier et le président du parti communiste chinois Xi Jinping, qui a accepté de fournir de puissantes technologies de surveillance à l’Arabie saoudite, a également suscité des inquiétudes. Marwa Fatafta, responsable politique de l’organisation de défense des droits numériques Access Now, basée à Berlin a averti que les capacités des villes intelligentes pourraient être déployées comme un outil de surveillance invasive par les forces de sécurité de l’État. Il pourrait s’agir de déployer une technologie de reconnaissance faciale pour suivre les mouvements en temps réel et de relier ces informations à d’autres jeux de données, telles que les informations biométriques. L’Arabie saoudite a fait la preuve qu’elle utilisait la technologie pour réprimer la liberté d’expression en ligne, notamment par l’utilisation du logiciel espion Pegasus pour surveiller les critiques et le vol des données personnelles des utilisateurs de Twitter qui ont critiqué le gouvernement.
L’initiative « Smart Nation » de Singapour a été lancée en 2014 pour exploiter les TIC, les réseaux et les données afin de trouver des solutions au vieillissement de la population, à la densité urbaine et à la durabilité énergétique. En 2023, Singapour a été nommée première ville asiatique dans l’indice Smart City de l’Institute for Management Development, qui classe 141 villes en fonction de la façon dont elles utilisent la technologie pour améliorer la qualité de vie. L’infrastructure de la ville intelligente de Singapour comprend des véhicules, des robots patrouilleurs programmés pour détecter les comportements « indésirables », des systèmes services publics domestiques des robots, travaillant dans la construction, les bibliothèques, les stations de métro, les cafés et l’industrie médicale, des systèmes de paiement sans espèces et des services de réalité augmentée et virtuelle. Des centaines d’appareils, de capteurs et de caméras répartis sur 160 kilomètres de routes express et de tunnels routiers (collectivement appelés Systèmes de transport intelligents ou STI) recueillent des données pour surveiller et gérer les flux de trafic et rendre les routes plus sûres. L’initiative de Singapour en matière de cyber santé comprend un portail en ligne qui permet aux patients de prendre rendez-vous et de renouveler leurs ordonnances, des services de télémédecine qui permettent aux patients de consulter des médecins en ligne, et des dispositifs portables IdO qui surveillent les progrès des patients pendant les séances de télé réadaptation. Dans un pays où l’on estime que 90 % de la population possède un smartphone, l’application Smart Nation de Singapour est une plate-forme unique permettant d’accéder à un large éventail de services et d’informations gouvernementaux.
En 2017, Toronto a attribué un contrat à Sidewalk Labs, une filiale « smart-city » [ville intelligente] d’Alphabet, la société mère de Google, pour aménager la façade maritime orientale de la ville en une utopie high-tech. Le projet visait à promouvoir un nouveau modèle de développement inclusif sur le site, « visant les niveaux les plus élevés de durabilité, d’opportunités économiques, d’accessibilité au logement et de nouvelle mobilité », et à servir de modèle pour résoudre les problèmes urbains dans les villes du monde entier. Sidewalk Labs a prévu de construire des logements durables, de nouveaux types de routes pour les voitures sans conducteur et d’utiliser des capteurs pour collecter des données et informer sur l’utilisation de l’énergie, contribuer à réduire la pollution et diminuer le trafic. Cependant, le projet a fait l’objet de critiques constantes de la part des habitants de la ville et même du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario concernant l’approche de l’entreprise en matière de protection de la vie privée et de propriété intellectuelle. Un expert en protection de la vie privée a quitté son rôle de consultant dans le cadre de l’initiative afin d’« envoyer un message fort » sur les problèmes de protection de la vie privée auxquels le projet était confronté après avoir appris que des tiers pouvaient accéder à des informations permettant d’identifier des personnes recueillies dans le quartier de la façade maritime. Le projet a finalement été abandonné en 2022, prétendument en raison de l’incertitude économique sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19.
Références
Vous trouverez ci-dessous les ouvrages cités dans cette ressource.
- Amnesty International. (2019). Smart Cities: Dreams Capable of Becoming Nightmares.
- Bonato, Danilo & Raimondo Orsini. (2018). Chapter 12 – Urban Circular Economy: The New Frontier for European Cities’ Sustainable Development. In: Clark, Woodrow W., ed. Sustainable Cities and Communities Design Handbook. Elsevier, pp. 235-245.
- Ekman, Alice. (2019). China’s Smart Cities: The New Geopolitical Playground. Institut français des relations internationales.
- Ellis, Rvan R. (2018). Ecuador’s Leveraging of China to Pursue an Alternative Political and Development Path. Journal of Indo-Pacific Affairs 1(1), pp. 79-104.
- Frey, Christopher. (2014). World Cup 2014: Inside Rio’s Bond-villian mission control. The Guardian.
- Harry, Charles T. (2019). The quiet threat inside ‘internet of things’ devices. The Conversation.
- Human Rights Watch. (2019). Interview: China’s ‘Big Brother App.’
- Larson, Christina. (2018). Who needs democracy when you have data? MIT Technology Review.
- Liceras, Patricia. (2019). These are the cyber threats that jeopardise the security of smart cities. Tomorrow Mag.
- Mosco, Vincent. (2019). A smart city does not have to become a surveillance city, but it requires a strong public commitment to privacy rights. BBC Science Focus.
- (n.d.). Regional, rural and urban development.
- Paquin, Alexandra Georgescu. (2015). The ‘smart’ heritage mediation. Smart City Journal.
- Pilkington, Ed. (2019). ‘Digital welfare state’: big tech allowed to target and surveil the poor, UN is warned. The Guardian.
- Power Technology. (2018). Will smart grids be vulnerable to cyber attacks?
- Privacy International. (2020). 2020 is a crucial year to fight for data protection in Africa.
- Ratcliffe, Rebecca. (2019). How a glitch in India’s biometric welfare system can be lethal. The Guardian.
- Rivière, Pauline. (2017). The framework that will make you understand e-participation. Citizen Lab.
- Smart City Hub. (2019). Smart cities may be a key natural disaster resource.
- Spinks, Rosie. (2015). Smartphones are a lifeline for homeless people. The Guardian.
- The Agility Effect. (2019). Smart Cities Face Interoperability Challenge.
- Thompson, Stuart A. & Charlie Warzel. (2019). Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy. The New York Times.
- Unal, Beyza. (2019). Smart cities are an absolute dream for infrastructure cyberattacks. Wired.
- (n.d.). Goal 11: Sustainable cities and communities.
- van Brakel, Rosamunde & Paul De Hert. (2011). Policing, surveillance and law in a pre-crime society: Understanding the consequences of technology based strategies. Journal of Police Studies 20(3), pp. 163-192.
- Wahba, Sameh. (2020). Here’s how technology is tackling inclusion issues in smart cities. World Economic Forum.
- Zetter, Kim. (2016). Inside the cunning, unprecedented hack of Ukraine’s power grid. Wired.
Ressources complémentaires
- Azarmi, Mana. (2020). Smart-Enough Cities: Governments That Seek Mobility Data Must Respect Individual Privacy. Center for Democracy and Technology (CDT).
- Baltac, Vasile. (2019). Smart Cities: A View of Societal Aspects. Smart Cities 2(4), pp. 538-548.
- Blum-Dumontet, Eva & Julia Manske. (2016). Lecture: “Who will be smart in a smart city? Upcoming challenges for privacy and open societies”. Re:publica.
- Cities Alliance. (2015). Future Cities Africa Global Knowledge Sharing Workshop.
- Smart Cities for All: une initiative menée par Victor Pineda, spécialiste du développement social et défenseur des droits des personnes en situation de handicap, qui vise à aider les urbanistes à créer des infrastructures intelligentes accessibles en fournissant des outils gratuits et téléchargeables permettant d’analyser les options technologiques et d’identifier les options les plus accessibles.
- Smart Cities Information System – SCIS: a knowledge platform for exchange and collaboration on smart cities.
- Townsend, Anthony. (2013). Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia: vidéo de sa présentation du livre à la New America Foundation en 2014.
- (2019). Smart Cities: Shaping the Society of 2030.
- United for Smart Sustainable Cities (U4SSC): une initiative des Nations unies coordonnée par l’UIT, la CEE-ONU et UN-Habitat pour atteindre l’ODD 11 : « Rendre les villes et les installations humaines inclusives, sûres, résilientes et durables ». Elle est divisée en groupes de travail thématiques autour de sujets tels que l’intelligence artificielle et la blockchain.